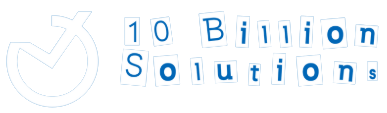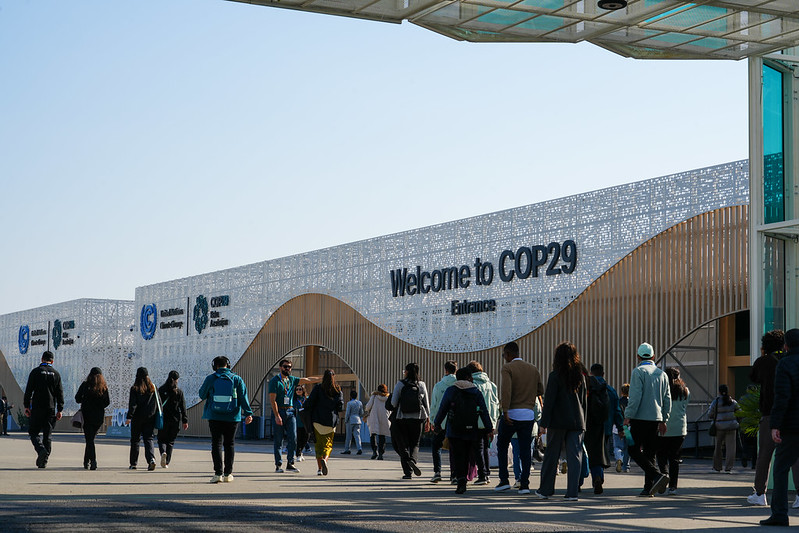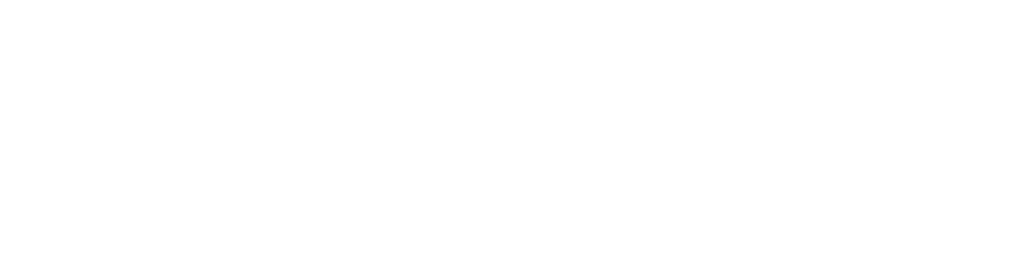L’étonnant pivot que les États-Unis viennent d’opérer en direction de la Russie exerce une pression énorme sur l’Ukraine et le reste de l’Europe, obligeant les pays européens aux actions d’urgence et au renforcement massif de leurs propres capacités de défense. La guerre en Ukraine et ailleurs fait rage, les dépenses militaires augmentent partout ; dans quelle mesure cela affecte-t-il les efforts en matière de climat et de développement durable, et que peut-on faire à ce sujet ?
Les premières conséquences de la guerre qui viennent à l’esprit sont les pertes en vies humaines et les destructions à grande échelle, et ce à juste titre. Cependant, les coûts écologiques, environnementaux et climatiques qui en découlent sont également stupéfiants, bien que largement ignorés.
Selon la dernière mise à jour de The initiative on GHG accounting of war, publiée le 24 février de cette année, le conflit russo-ukrainien a émis 30 % de plus de gaz à effet de serre ayant une incidence sur le climat au cours de la troisième année de guerre qu’au cours de la deuxième année de guerre, soit 55 millions de tonnes supplémentaires d’équivalent CO2. Ces émissions de gaz à effet de serre sont dues à la guerre, à la reconstruction des bâtiments, aux incendies de forêt (en forte augmentation également, en raison de la sécheresse), aux dommages causés aux infrastructures énergétiques et aux perturbations pour l’aviation civile. Les trois années de guerre ont généré au total 230 millions de tonnes d’équivalent CO2, soit l’équivalent des émissions annuelles de 120 millions de voitures à carburant fossile.
Outre les guerres en cours – Ukraine, Moyen-Orient, République Démocratique du Congo, pour n’en citer que quelques-unes -, le climat géopolitique actuel est clairement propice à :
- Une confrontation militaire brutale entre États, ou un risque accru de confrontation, conduisant à des courses aux armements,
- Un affaiblissement spectaculaire des processus multilatéraux, et en réalité une perte de confiance en la résolution pacifique des conflits,
- Une montée des partis politiques ou des États autoritaires, souvent fortement populistes, anti-« woke » et anti-environnement,
- Et une réaction brutale contre les actions et les réglementations en matière de climat et d’environnement.
Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre le coût climatique de la guerre et d’intégrer ces connaissances afin d’influencer la lutte contre ces puissants vents contraires additionnels.
Quel est le coût climatique de la guerre ?
Les guerres et les préparatifs militaires ont des conséquences profondes et souvent négligées sur l’environnement et le climat mondial. Dans un contexte d’escalade des tensions géopolitiques, ces impacts environnementaux s’aggravent. Les conflits et les investissements en matière de défense exacerbent la dégradation de l’environnement et le changement climatique, alors que le sujet du réchauffement de la planète semble relégué à une priorité lointaine.
Dommages environnementaux causés par les guerres
Les guerres laissent une marque indélébile sur les écosystèmes. Les explosions libèrent dans l’air, le sol et l’eau des produits chimiques toxiques tels que le plomb, le mercure et l’uranium appauvri. Ces polluants persistent pendant des décennies, contaminant les terres agricoles et les sources d’eau, comme on l’a vu en Ukraine où 12 000 kilomètres carrés de réserves naturelles ont été dévastés. En outre, les bombardements détruisent les habitats naturels, perturbent la faune et la flore et contribuent à la perte de biodiversité.
La guerre entre la Russie et l’Ukraine illustre le bilan environnemental des conflits modernes. Au cours de sa seule première année, la guerre a généré plus d’émissions de gaz à effet de serre (GES) que certains pays entiers, comme la République tchèque. Les incendies, les explosions et la destruction des infrastructures ont libéré 120 millions de tonnes d’équivalent CO₂ au cours des 12 premiers mois, ce qui est également comparable aux émissions annuelles de la Belgique. Les efforts de reconstruction amplifieront encore les émissions, en raison des processus de reconstruction à forte intensité énergétique.
Les écosystèmes marins souffrent également. Par exemple, la pollution chimique de la mer Noire causée par la guerre a mis en danger la vie marine. Les mines terrestres et les munitions non explosées entravent la régénération des terres et la reprise de l’agriculture longtemps après la fin des conflits.
Émissions militaires et changement climatique
Les armées comptent parmi les institutions qui contribuent le plus aux émissions de gaz à effet de serre. Si elle était considérée comme un pays, l’armée américaine se classerait à elle seule au 47e rang mondial des émetteurs, et ce uniquement en tenant compte des émissions liées à l’utilisation de carburant. La production d’armes et d’équipements génère également d’importantes émissions.
Les guerres perturbent l’action en faveur du climat en détournant les ressources vers les dépenses de défense plutôt que vers les initiatives de développement durable ou les énergies renouvelables. Par exemple, les conflits déclenchent souvent des pénuries d’énergie qui entraînent une dépendance accrue aux combustibles fossiles, ce qui compromet les accords mondiaux sur le climat tels que l’Accord de Paris sur le changement climatique.
Les changements géopolitiques à l’origine des dépenses de défense
En réponse aux préoccupations croissantes en matière de sécurité, largement motivées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les pays européens ont considérablement augmenté leurs budgets militaires. Les dépenses de défense de l’UE atteindront 326 milliards d’euros en 2024, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2021. Cette augmentation reflète une tendance plus large à donner la priorité à la défense plutôt qu’aux investissements dans le domaine du climat, qui a été accélérée par les revirements récents et spectaculaires des États-Unis en matière de politique étrangère.
D’une manière générale, les changements géopolitiques ont relancé une course aux armements qui détourne l’attention des défis climatiques urgents. Le regain d’intérêt pour la militarisation relègue le réchauffement climatique au second plan. Les ressources qui pourraient financer des projets d’énergie renouvelable ou des mesures d’adaptation au climat sont plutôt affectées au développement et à l’acquisition d’armes. En voici un exemple :
- Plus de 80 % des investissements de l’UE dans la défense en 2023 ont été alloués à de nouveaux équipements militaires plutôt qu’à des technologies durables.
- La reconstruction des régions déchirées par la guerre nécessitera des apports massifs d’énergie, ce qui retardera encore les progrès vers les objectifs d’émissions nettes nulles.
Cette dynamique crée un cercle vicieux : les guerres aggravent le changement climatique en raison des émissions et de la destruction de l’environnement, tandis que le changement climatique lui-même exacerbe les conflits liés aux ressources.
La prise de conscience mène à l’action
Comme l’indique un récent article d’opinion du New York Times, « une grande partie de la science récente voit les racines de la crise climatique dans les technologies de transformation et les phases concomitantes du capitalisme : la plantation, la machine à vapeur, la mondialisation de la fin du 20e siècle. Mais on a étonnamment peu parlé ces derniers temps de la place centrale de la guerre dans le récit des menaces environnementales mondiales ».
Compte tenu de cette réalité méconnue, et alors que les nations se préparent à d’éventuels conflits futurs, il est urgent de se pencher sur les coûts environnementaux de la militarisation. Le meilleur scénario serait évidemment de restaurer la confiance, le multilatéralisme et le contrôle des armements. Malheureusement, il ne s’agit pour l’instant que d’un vœu pieux. Dans le contexte actuel de course aux armements, les politiques possibles sont les suivantes :
- Réduire les émissions militaires : La transition des opérations militaires vers des sources d’énergie renouvelables pourrait réduire de manière significative les émissions, tout en diminuant la dépendance à l’égard des fournisseurs externes de combustibles fossiles,
- Donner la priorité au climat dans la stratégie géopolitique : Les gouvernements doivent trouver un équilibre entre les préoccupations sécuritaires et les engagements en faveur de l’action climatique. Cette tâche est rendue beaucoup plus difficile par l’explosion des déficits budgétaires, mais les risques immédiats ne doivent pas nous faire oublier les risques massifs à plus long terme,
- Efforts de reconstruction écologique : La reconstruction d’après-guerre devrait intégrer des pratiques durables afin de minimiser les dommages environnementaux à long terme.
On souhaiterait bien sûr que les tensions géopolitiques soient mises sous contrôle et résolues, mais elles continueront à éclipser les priorités climatiques dans un avenir proche. Cependant, il est impératif pour les citoyens et les dirigeants de les réduire autant que possible et de prendre en compte le coût climatique et environnemental de la guerre. Si nous ne parvenons pas à résister à ces vents mauvais et à les dompter, les générations futures devront supporter le poids des destructions causées par les conflits et du réchauffement planétaire non maîtrisé.
L’impact de la guerre sur le climat ne peut plus être ignoré. Si vous souhaitez recevoir d’autres analyses sur la géopolitique, le développement durable et l’avenir de la planète, inscrivez-vous à notre newsletter et restez à l’écoute.