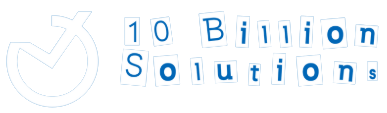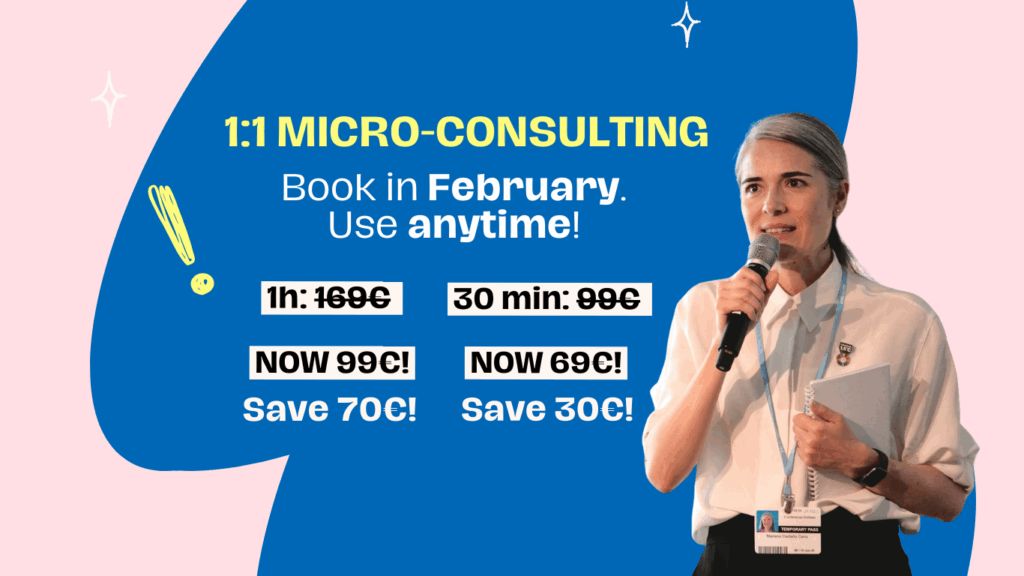Au cours des 20 dernières années, la couverture médiatique du changement climatique a clairement progressé : plus d’infos dans les médias, plus de spécialisation dans les rédactions et plus de journalistes qui couvrent le sujet. Mais depuis 2022, et de manière plus marquée depuis un an et demi, nous entrons dans une nouvelle phase avec moins de couverture médiatique du changement climatique en général, même s’il y a quelques exceptions qu’on abordera ultérieurement.
Le sujet perd de son attrait dans les médias, même si les impacts du changement s’intensifient et que les preuves scientifiques sont plus alarmantes que jamais. En effet, les rédacteurs en chef donnent la priorité à d’autres questions telles que les tensions géopolitiques, la crise économique ou la sécurité. À cela s’ajoute une certaine lassitude du public face à un excès de discours catastrophistes.
Pour comprendre ce qui se passe et pourquoi, nous proposons cette réflexion nécessaire, car la baisse de la couverture médiatique du changement climatique affecte la qualité du débat et, en fin de compte, la capacité des gouvernements et de la société à agir.
Je présente ici cinq éléments essentiels pour comprendre ce qui se passe.
1. Après 20 ans de hausse, les données montrent un tournant
Les données de l’Observatoire des médias et du changement climatique de l’université du Colorado à Boulder, qui analyse 131 médias dans 58 pays, dont l’Espagne, sont claires : au cours des vingt dernières années, l’attention médiatique portée au climat n’a cessé de croître, même si elle a connu des hauts et des bas qui coïncident avec les étapes importantes du processus multilatéral (comme les COP de Copenhague en 2009, Paris en 2015 ou Glasgow en 2021), avec des phénomènes météorologiques extrêmes (comme des inondations, des ouragans ou des typhons) et des moments de forte mobilisation sociale (comme les manifestations et les mouvements de jeunes de 2019 de Fridays for Future ou Extinction Rebellion).

La COP de Glasgow en 2021 a marqué l’un des plus forts rebonds après le ralentissement de l’info pendant la pandémie. Mais depuis, on voit une tendance à la baisse. Elle reste plus élevée qu’avant 2018, mais elle baisse, et ça continue.
Les éditeurs accordent moins de place au changement climatique, les politiciens en parlent moins dans leurs discours ou, lorsqu’ils le font, c’est comme une arme politique, les sondages montrent une baisse de l’inquiétude des citoyens pour qui le changement climatique reste une source de préoccupation, mais moins que la crise du coût de la vie ou la sécurité.

2. Moins de couverture médiatique, moins d’inquiétude, moins de pression politique : un cercle vicieux difficile à briser
Ici, on ne débat pas pour savoir si la baisse commence dans les médias, chez les politiciens ou chez les citoyens. C’est un cercle vicieux qui s’autoalimente.
Quand le climat perd de l’espace médiatique, les citoyens cessent de le percevoir comme une question urgente. Quand l’inquiétude baisse, le climat perd de son importance politique. Et quand il perd de son importance politique, les médias en parlent moins.
Le résultat, c’est un cercle vicieux : moins de discussions, moins de recherches, moins de suivi et donc moins de capacité à garder en vie un sujet qui demande de la continuité. C’est particulièrement grave parce que la physique du climat n’attend pas. Pendant que les discussions s’éteignent, les impacts et les émissions continuent d’accélérer.
3. Le changement climatique devient un champ de bataille idéologique
Au cours de l’année dernière, le changement climatique a été absorbé par la dynamique de la polarisation politique. Le cas le plus extrême est celui des États-Unis, où la position sur le climat est souvent associée à l’identité partisane. Mais en Espagne, nous commençons également à observer les mêmes tendances : le climat, ses impacts et ses solutions sont utilisés pour marquer une distance idéologique.
Cette politisation brise quelque chose d’essentiel : le consensus autour de la science du climat. La science ne fait pas de vagues, contrairement à la politique. Et quand le climat est vu comme un signe d’identité politique et pas comme un phénomène physique qui nous touche tous, le débat devient plus fragile et plus instable.
Pour les journalistes, ça veut dire une climat plus hostile, où expliquer ce que dit la science peut être vu comme un « positionnement politique », même quand ce n’est pas le cas.

4. Des émissions record et un écosystème de l’information intoxiqué par la désinformation
Alors que le débat se refroidit, les émissions continuent d’augmenter. 2025 s’annonce comme une nouvelle année record, avec un dépassement temporaire de la limite de 1,5 °C et des impacts qui croissent de manière exponentielle, et non linéaire.
Et tout ça se passe dans un contexte où la désinformation se développe rapidement. Les réseaux sociaux sont un espace peu réglementé, où les contenus faux se propagent comme une traînée de poudre. La désinformation climatique, en particulier, devient un élément structurel du débat public. Et elle ne se limite pas aux réseaux sociaux : elle s’infiltre aussi petit à petit dans certains médias.
Pour le journalisme climatique, ça veut dire travailler dans un contexte où la clarté est plus difficile à atteindre et où le bruit est plus fort. Et où les démentis, même s’ils sont nécessaires, atteignent rarement la vitesse des contenus faux.

5. Le rôle du journalisme à l’ère du « Far West » de l’information
Les Nations Unies, en collaboration avec la présidence de la COP30 au Brésil, ont lancé une initiative pour défendre l’intégrité de l’information climatique. C’est une étape importante, mais insuffisante si elle ne bénéficie pas des ressources et du soutien des plateformes de réseaux sociaux et des régulateurs.
Les médias, en revanche, peuvent agir avec un impact immédiat. Dans un environnement où n’importe qui peut publier n’importe quoi sans conséquences, le journalisme devient un outil essentiel pour défendre l’information véridique : informer avec rigueur, contextualiser, vérifier, démentir, expliquer les tendances et soutenir un débat public fiable.
On ne pourra pas fermer toutes les portes à la désinformation, mais on peut renforcer les contrepoids démocratiques qui la rendent moins nuisible. C’est aujourd’hui l’une des missions les plus importantes du journalisme climatique.
Cette analyse est issue de mon intervention lors du XVIe Congrès national du journalisme environnemental de l’Association des journalistes d’information environnementale (APIA) qui s’est tenu à Madrid les 26 et 27 novembre 2025. Je suis extrêmement reconnaissante pour l’invitation et pour le travail de l’APIA, plus nécessaire que jamais, afin de soutenir une information climatique rigoureuse en Espagne. J’espère que cette réflexion et le débat organisé par l’APIA contribueront à élargir une conversation urgente pour l’avenir du journalisme et de l’action climatique. Vous pouvez voir ici mon message vidéo complet.
Si vous travaillez dans la communication, le journalisme ou le développement durable et que vous voulez continuer la conversation, écrivez-moi à mariana@10billionsolutions.com et inscrivez-vous à notre newsletter.