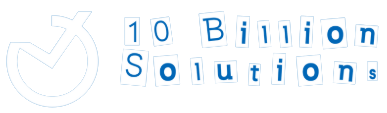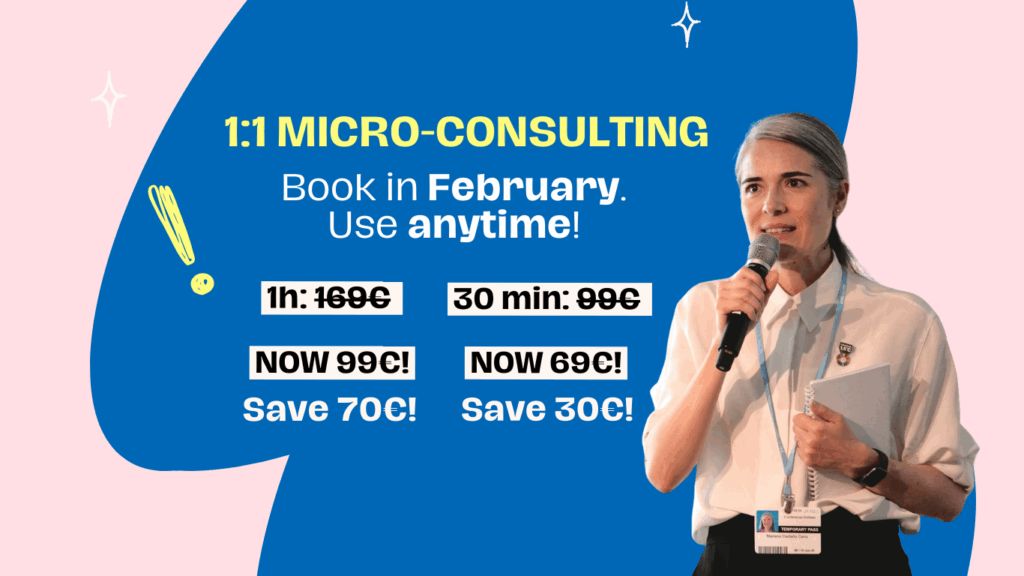La marée qui s’est transformée en tsunami: de la fast fashion à l’ultra-fast fashion
Cela a commencé il y a longtemps par une marée : les marques de fast fashion telles que Zara et H&M se sont imposées comme les favorites des acheteurs à la recherche de vêtements très abordables et à la mode. Le phénomène a été aggravé par l’adoption exponentielle des achats en ligne, au point que plus de 20 % des ventes de vêtements se font en ligne aujourd’hui – et dans l’UE, 42 % des particuliers ont acheté des vêtements, des chaussures ou des accessoires en ligne en 2022. Ceci est souvent associé à des habitudes de gaspillage telles que la commande de différentes tailles d’un article pour l’essayer à la maison et le retour de tous les articles sauf un, ce qui multiplie l’empreinte carbone des livraisons.
Les magasins et chaînes de vêtements réels souffrent énormément. La marée s’est transformée en tsunami, les gagnants étant les marques de mode ultra-rapide comme Shein et Temu, et Amazon. Shein, avec ses 7 000 nouveaux articles de vêtements mis en ligne chaque jour, et ses concurrents dans le domaine de la mode ultra-rapide, continuent de gagner des parts de marché. Grâce à ce modèle de catalogue en constante évolution et de bas prix, Shein et ses pairs séduisent ceux qui, en ces temps de pouvoir d’achat sous pression inflationniste, veulent acheter de nouveaux vêtements sans trop sacrifier d’autres dépenses, telles que le logement ou les abonnements aux divertissements numériques.
Cette industrie colossale, caractérisée par des cycles de production rapides, des collections sans cesse renouvelées et des prix incroyablement bas, se nourrit du désir constant de nouveauté des consommateurs, encourageant une culture du jetable qui est de plus en plus en contradiction avec la tendance mondiale vers la durabilité et la préservation de l’environnement. Alors que l’Europe est en première ligne dans la mise en œuvre de politiques climatiques et d’efforts de durabilité solides, l’industrie de la mode éphémère apparaît comme un défi de taille pour l’avenir écologique du continent.
Des impacts sociaux et environnementaux graves
L’empreinte environnementale de la fast fashion est stupéfiante, ce qui en fait un sujet de préoccupation majeur pour les décideurs politiques européens. L’industrie est l’un des plus gros consommateurs d’eau au monde, nécessitant des milliers de litres pour produire un seul vêtement. De plus, l’utilisation de fibres synthétiques comme le polyester, un produit pétrolier, contribue de manière significative à l’empreinte carbone de l’industrie. Le processus émet non seulement une quantité considérable de gaz à effet de serre, mais entraîne également la prolifération de microplastiques dans nos océans, ce qui constitue une grave menace pour la vie marine et les écosystèmes.
Le défi de la gestion des déchets exacerbe encore la crise environnementale. En Europe, des millions de tonnes de déchets textiles sont générés chaque année, dont une part importante finit dans des décharges ou des incinérateurs. Cela gaspille non seulement des ressources précieuses, mais libère également des polluants nocifs dans l’environnement.
Construire des digues en Europe contre l’impact climatique de la fast fashion
Les décideurs politiques européens ont commencé à prendre des mesures décisives. L’Union européenne (UE), par exemple, a lancé plusieurs initiatives visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile. Le plan d’action de l’UE pour une économie circulaire, qui s’inscrit dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, vise à garantir que les produits soient conçus pour être plus durables, réutilisables, réparables et recyclables, en ciblant directement le modèle de la fast fashion. En outre, la stratégie pour des textiles durables et circulaires vise à améliorer l’empreinte de l’industrie en encourageant l’innovation dans les fibres durables, en promouvant des modèles commerciaux qui peuvent prolonger la durée de vie des articles de mode et en encourageant des comportements de consommation plus responsables.
Cependant, ces initiatives ne peuvent guère réussir sans un changement profond des mentalités : les mesures réglementaires doivent non seulement favoriser, mais aussi s’appuyer sur un changement culturel qui valorise la qualité plutôt que la quantité, et la durabilité plutôt que la gratification instantanée. La nature mondiale de la chaîne d’approvisionnement textile complique les efforts de réglementation et de contrôle des normes environnementales, ce qui nécessite une coopération internationale et souligne à nouveau l’importance d’un changement de comportement des consommateurs.
Essayer de nouvelles mesures au niveau national
La France, par exemple, a récemment fait adopter un nouveau projet de loi visant à réduire l’engouement pour la mode éphémère et la surconsommation alimentée par les entreprises de mode jetable. Selon Refashion, l’éco-organisme de l’industrie du textile, du linge de maison et de la chaussure, 3,3 milliards de vêtements ont été vendus en France en 2022, soit 48 par habitant. Le texte, examiné par l’Assemblée nationale jeudi 14 mars, a déjà reçu le soutien du gouvernement.
« Notre ambition est de réduire l’achat compulsif, qui a des conséquences environnementales, sociales et économiques », explique Anne-Cécile Violland, la députée à l’origine de la proposition de loi, en rappelant que le secteur textile représente 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le projet de loi inclurait un système de bonus-malus et interdirait la publicité. Pour l’instant, seules les enseignes de la fast fashion comme Shein et Temu sont visées. Le texte prévoit une « pénalité de cinq euros par produit pour les producteurs qui introduisent plus de 1 000 nouveaux modèles par jour ». D’ici à 2030, cette pénalité appliquée à l’entreprise pourrait atteindre jusqu’à 10 euros par produit, plafonnée à 50 % du prix de vente hors taxes. Cette somme sera reversée à l’éco-organisme Refashion.
En revanche, les entreprises dites « vertueuses », dont l’impact sur l’environnement est limité, auront droit à un « bonus », également plafonné à 50 % du prix de vente hors taxes, versé par Refashion.
Par ailleurs, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé lundi 4 mars que le gouvernement allait « lancer une campagne de communication ciblée contre la mode éphémère », en partenariat avec l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).
Si les critiques ne tardent pas à rétorquer que ce texte « ne s’attaque pas à l’impact environnemental de la mode, mais affecte le pouvoir d’achat des consommateurs français », en discriminant les revenus les plus faibles, ce sont là des signes certains de profonds changements dans la perception du gouvernement et des citoyens vis-à-vis de la fast fashion.
En adoptant les principes de l’économie circulaire, en investissant dans des technologies durables et en encourageant une culture de consommation responsable avec des mesures socialement justes, l’Europe peut atténuer l’impact environnemental de la fast fashion et conduire le monde vers une industrie de la mode plus durable et plus équitable. Comme pour la plupart des autres urgences climatiques et environnementales, il s’agit d’un défi de taille, mais essentiel à relever.
Vous pouvez regarder la contribution de Mariana Castaño Cano à ce numéro – en espagnol avec sous-titres – dans l’émission En Primera Plana, sur RFi. N’oubliez pas que vous pouvez trouver d’autres nouvelles comme celle-ci dans notre section actualités et nos ressources dans Academy :